Detachment, de Tony Kaye, 2011.
Dans une critique plutôt assassine[1],
Olivier Guichard reproche, entre autres, au film Detachment d’hésiter entre le tableau social d’un système éducatif
en crise et le portrait psychologique du personnage principal Henry. Pourtant, il ne
semble pas qu’il s’agisse là d’une indécision du metteur en scène mais
au contraire la volonté de maintenir ensemble les deux plans, en réalité
indissociables.
Ce film réalisé par Tony Kaye (American History X en 1998) d'après un
scénario de Carl Lund, enseignant, a pour motif principal l'éducation et dresse
un amer constat sur le système éducatif
américain mais aussi les rapports aux autres dans notre société contemporaine. Dans
un entretien, Tony Kaye précisait ceci : « Je veux parler des grands
sujets de société. Et l'enseignement aux Etats-Unis en est un particulièrement
sensible et grave. A mes yeux, le métier de professeur devrait être aussi
important que celui de médecin. Un professeur est l'architecte du monde. Il
apprend à nos enfants à devenir des êtres humains. Hélas, cette profession a
été assassinée. Cela doit changer, sinon nous sommes damnés! Mais qui veut
enseigner aujourd'hui ? Les profs sont mal considérés, mal payés, ont perdu la
foi, tombent dans la dépression. Ils ont affaire à des ados souvent violents
qui ont perdu le désir d'apprendre. Sans parler de leurs parents
démissionnaires. Il faudrait que ce job retrouve de sa splendeur pour attirer
des jeunes gens brillants, intelligents qui deviendraient des rock stars de
l'enseignement. » Film de fiction, Detachment
saisit de près et de manière plutôt réaliste - Kaye est aussi documentariste -
certains aspects de l'école d'aujourd'hui. Nous y voyons aussi personnellement une réflexion plus large sur la
nécessité, les difficultés voire les impasses du soin, compris non
exclusivement comme soin médical - même s’il en est un peu question dans le
film - mais surtout plus largement en tant que souci pour le bien-être matériel
et spirituel d’autrui, préoccupation du sort et de l’amélioration des
conditions d’existence d’autrui[2].
Henry Barthes (remarquablement interprété par
Adrien Brody, Oscar du meilleur acteur pour The
Pianist de R. Polanski) est un professeur de littérature remplaçant. Ce
statut lui permet d'éviter les liens affectifs avec ses collègues et ses
élèves. Il pratique à cet égard le détachement le plus total et vit seul.
Appelé donc à effectuer un remplacement de routine d'une durée d'un mois, il
débarque dans un lycée de très mauvaise réputation de la banlieue new-yorkaise.
Les conditions de travail, malgré la volonté de la Proviseure de faire de son
mieux, y sont difficiles : élèves irrespectueux (chahut, provocations en
tout genre, insultes, crachats, bagarres, cruautés...), démotivés et apathiques,
sans idéaux, tantôt abandonnés à eux-mêmes par des parents absents ou débordés,
tantôt décidés à contester les décisions professorales avec l'aide de parents
complices ; Proviseure jugée incompétente et menacée de mise au placard
par sa hiérarchie ; collègues désabusés voire dépressifs. Le premier
contact de Mr Barthes avec sa classe est décisif. Fixant pour seule et
unique règle cavalière à ses élèves de ne rester en cours que s'ils le
souhaitent, il parvient à se débarrasser de l'élément le plus contestataire. Barthes
fait preuve d'un grand sang-froid, d'un self-control remarquable :
lorsqu'un autre élève le provoque et l'insulte, il l'amène le plus calmement du
monde à lui faire prendre conscience qu'il est sans doute le seul dans
l'établissement à vouloir l'aider. Le conflit est désamorcé et dès lors, sans
pour autant avoir affaire à une classe très motivée, l'enseignant parvient
à se faire écouter. Le message du pédagogue est clair : seule une prise de
conscience de sa situation par chacun et la volonté de s'en sortir peut
permettre sinon une réussite scolaire et sociale du moins une prise en main de
son destin. Durant sa période de remplacement, Henry Barthes se montre
particulièrement à l'écoute de Meredith (interprétée par Betty Kaye),
jeune fille obèse, mal dans sa peau et dont les talents artistiques sont
raillés par un père méprisant. Celle-ci tombe peu à peu amoureuse de son
professeur sans que celui-ci s'en aperçoive jusqu'au jour où, seuls dans la
classe, les corps se rapprochent. L'un veut consoler, l'autre veut étreindre.
C’est alors que Madison, sa jeune collègue, fait irruption dans la pièce. La
jeune fille s'enfuit tandis que la collègue soupçonne Barthes, à la vue
de cette étreinte ambiguë, de ce dont il n'a jamais eu l'intention. Henry
s’emporte, perd la maîtrise qui semblait le caractériser. C’est que l'épisode
ramène au douloureux passé du professeur – une mère suicidée à cause de
relations incestueuses contraintes avec un père arrivé désormais en fin de vie
dans un état de démence et dont Henry se charge malgré l'ignominie
probable - en même temps qu'il présage des conséquences inattendues et
catastrophiques, le suicide de Meredith.
Malgré ses ratés, l'intérêt du film est
multiple. D'abord, le tableau qu'il brosse du système éducatif américain ne
peut que nous interpeller. Au-delà de ce contexte particulier, l'on ne peut
qu'être sensible à ce qu'il nous montre de la condition enseignante en
générale. Si nous sommes ici dans la fiction et si l'on peut soupçonner
certains passages de verser dans la caricature, le récit reste révélateur du
sentiment subjectif des personnels enseignants, de certaines données objectives
aussi concernant le monde de l'école aujourd'hui. Sur ce dernier point, on
évoquera par exemple la réunion de parents qui, désertée par ces derniers,
laissent les enseignants désemparés ; les réactions vives et mêmes
violentes d'une mère, puis d'un père contre certaines décisions professorales
justes visant leur enfant; la soumission du système scolaire aux diktats du capitalisme qui
réclame de l'efficacité, des résultats et qui fait de l'éducation, selon une
logique néolibérale, un objet de marchandisation. En prenant le parti, dès le
générique, d'exposer le point de vue de la communauté enseignante (les raisons
pour lesquelles chacun a choisi ce métier), le film nous donne aussi à voir et
à penser l'expérience intime du métier d'enseignant : selon les
personnages, on navigue de la terreur face aux élèves à l'envie véritable de
leur venir en aide. Mais le plus souvent, c'est le sentiment d'impuissance,
l'abattement, le désespoir qui l'emportent. La désaffection parentale, le
renoncement des élèves, leurs incivilités, l'ingratitude de la société à
l'égard du travail et des efforts du corps enseignant, le mépris et l'absence
de reconnaissance, autant d'éléments qui dressent un bilan pessimiste du métier
et laissent peu d'espoir pour l'avenir de l'éducation dans le monde.
Le monologue désabusé du narrateur et personnage
principal du film, entretien témoignage en noir et blanc, qui en constitue le fil conducteur et en
ponctue le déroulement, contribue fortement à la prise de conscience de
l'impuissance, de la perte irrémédiable, de la catastrophe. Personnage
complexe, atypique, solitaire et mystérieux, Henry dissimule derrière une
apparence stoïque, son histoire personnelle passée non seulement à ses élèves,
ce qui est compréhensible, mais aussi à ceux qui le côtoient de plus près (une
collègue Mrs Sarah Madison, interprétée par Christina Hendricks ; une
jeune prostituée Erica, interprétée par Sami Gayle, qu'il héberge chez lui et
qu'il tente d'arracher à son calvaire). Les scènes de flashback, souvenirs de
sa mère disparue qui viennent contaminer la narration, témoignent d'un passé
qui le hante et d'une compulsion de répétition qui l'empêche manifestement
d'investir pleinement son présent et de s'engager de manière optimiste et
confiante dans l'avenir. Ses blessures l'ont marqué à vie, ce qui explique son
tourment, ses errances méditatives et ses nombreux journaux autobiographiques
et poétiques. Son détachement, conséquence de la perte et de la volonté de se
protéger d'une réalité trop cruelle, constitue sa manière personnelle de
réinvestir son environnement. Pourtant, ce détachement n’est pas un égoïsme.
Car, de fait, il est tout sauf indifférent aux autres : un peu toujours
malgré lui, il est vrai, et de manière inattendue, il prête une réelle et
sincère attention à ses élèves, prêt à aider ceux qui comme lui semblent le
plus en perdition afin de leur redonner le désir de se construire ; il
protège sous son aile cette jeune prostituée humiliée et lui permet de
reconquérir sa dignité ; mieux, il pardonne à son grand-père, malgré ses
soupçons d'abus sexuels à l'égard de sa mère, lui rend régulièrement visite à
l'hôpital et lui permet de quitter cette vie l'âme en paix ; il est même
le seul à s'apercevoir de la détresse de l'un de ses collègues terrorisé et
cramponné au grillage du lycée. Bref, il s'attache à soigner les blessures de
chacun, tirant profit de sa propre résilience que l'on devine pourtant inachevée
au point où l'aide qu'il apporte aux autres constitue une manière de continuer
de se soigner lui-même. Telles sont ses propres ressources pour combattre ses
démons et trouver quelque beauté dans l'existence[3]. Mais
rien n'y fait vraiment. Les stigmates de son traumatisme passé se manifestent
sur son visage et son allure : il est et reste triste et mélancolique. Et
l'issue fatale du suicide de la jeune adolescente ajoute à sa peine
existentielle et confirme le sentiment de tragique. Au flegme impassible
caractérisant le personnage en début de film ont succédé la colère, le doute
profond, l'effondrement. La souffrance est indépassable car le chaos se
rappelle à lui. « Nous échouons », répète Henry. Nous échouons
nécessairement. Accablé par sa responsabilité, Henry exprime son
désarroi : « Tous les enseignants ont, à un moment, cru qu'ils
pouvaient changer les choses. Un jour, on se réveille et on réalise qu'on a
échoué. » Selon les aveux mêmes du réalisateur, le film pose de cette
manière la question de la responsabilité individuelle et collective : de
quelles ressources dispose aujourd'hui l'enseignant et que doit-il faire dans
sa classe pour affronter le reflet de la violence qui gangrène la
société ? Le film ne nous invite-t-il pas à penser que, pour dépasser son
impuissance, l'enseignant d'aujourd'hui doit assumer la gageure de transformer
son enseignement en art véritable? En tout état de causes, il s'agit de
combattre le chaos.
C'est cette conviction acquise de ses
expériences qui porte Henry à sensibiliser ses élèves à la littérature, à
tenter d'éveiller leur esprit. Le suicide de Meredith survenu, cette
conviction est désormais profondément ébranlée. Impuissante, incapable
d'entendre cette parole, l'adolescente décide de se donner la mort. On peut au
final interpréter ce geste désespéré comme un refus de soin, parce qu'une vie
subjectivement vécue sans reconnaissance, que cette reconnaissance soit
amoureuse, familiale ou sociale, ne vaut pas la peine d'être vécue. Dès lors,
le chaos risque inexorablement de triompher : tel est le sens de la mise
en scène apocalyptique de l'imaginaire d'Henry qui le montre seul dans sa
classe dévastée, sens dessus dessous. A ce stade du drame, Henry se dit
lui-même creux, il se sent vide et a bien le sentiment de n'être personne.[4] Pourtant, aussi dure que soit l'existence, ses
ressources ne sont-elles pas infinies ? Henry ne le sait-il pas, lui qui
s'en remet à l'art en guise de thérapie ? N'est-ce pas l'art et lui seul qui, transfigurant
l'existence, permet d'en supporter la souffrance ? L'écriture consignée
dans ses cahiers durant toutes ces années et la lecture en classe du magnifique
début de la nouvelle d'Edgard Allan Poe (La
chute de la maison Uscher) en toute fin de film, exprimant adéquatement les
sentiments intérieurs d'Henry, peuvent
le laisse penser.
En outre, malgré la mort de Mérédith que n'a pas
pu empêcher Henry, ce dernier trouve réconfort dans la « relation
familiale » qui s'établit finalement avec Erica. Faute de n'avoir pu
sauver son élève Mérédith, il sauve la fugueuse Erica.
On soulignera dès lors le paradoxe
suivant : la difficulté du vivre ensemble, difficulté soulignée par la
tâche éducative et la tentative de soin qui naissent toutes deux de notre
attachement fondamental aux autres[5], ne
peut être raisonnablement réglée sans une certaine et nécessaire dose de
détachement, de prise de « juste distance » les uns à l'égard des
autres. Car sans cette « juste distance », triompheraient aussi bien
une promiscuité étouffante et insupportable qu'une indifférence non moins
tolérable. La séparation comme l'union la plus intime peuvent être source de
destruction. Le film de Tony Kaye donne bien à penser que le sens de
l'existence fluctue au grès de nos relations sociales changeantes et que,
souvent déchirés entre le besoin d'autrui, la solitude subie et le détachement
volontaire, nous doutons et désespérons de ce sens. L'œuvre artistique,
cinématographique en particulier, nous donnant à voir et à penser notre
expérience, peut peut-être alors, par ses ressources, « domestiquer le
scepticisme »[6], conditionner un réveil,
constituer une thérapie nous indiquant que seules l'union et la séparation
créatrices redonnent sens à la vie[7].
Parlant de son film, le réalisateur évoque
« un paysage d'émotions ». On peut à juste titre se méfier de l'excès
de pathos au cinéma. Pour autant, par son jeu tout en retenue et l’exploitation
de ses propres failles, Adrian Brody parvient à incarner cette figure tragique
et à dévoiler sous la façade apparemment indifférente de son personnage une
sensibilité à fleur de peau (faut-il la rapprocher de l'hyper-sensibilité du
personnage de Roderick dans la nouvelle de Poe?), un écorché vif qui ne s'est
jamais véritablement remis de son enfance et qui peine, tant bien que mal, à
exorciser sa souffrance par l'écriture et s'ouvrir de nouveau aux autres.
Comprenant qu'il est impossible et vain de vouloir se détacher pleinement – ce
serait se fermer au monde – il comprend aussi que seul l'attachement et les
expériences de l'amour, de l'éducation et du soin nous mettent à l'épreuve du
réel et nous posent la question du sens de la vie. Professeur de littérature,
Henry est aussi philosophe.
« Et jamais je n’ai
senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au
monde… »
Camus, Noces, « Le
vent à Djémila », Paris, Gallimard, « Folio-essais », p.26.
[1] Télérama, février 2012.
Pour d’autres critiques, consulter http://ednat.canalblog.com/archives/2012/02/05/23448143.html
et http://www.allocine.fr/film/fichefilm-193427/critiques/presse/
[2] Céline Lefève, « La Philosophie du soin »,
in La Matière et l’esprit, n° 4 : « Médecine et philosophie » (dir.
D.Lecourt), Université de Mons-Hainaut, avril 2006, p. 25-34.
[3] On peut se reporter au
livre de Frédéric Worms, Revivre,
Eprouver nos blessures et nos ressources, Paris, Flammarion, 2012.
[4] Se référer à la chanson Empty de Ray LaMontagne qui fait partie
de la bande son.
Voir aussi l’article de Claire Cornillon : http://lintermede.com/cinema-detachment-tony-kaye-adrian-brody-festival-deauville-2011.php
Voir aussi l’article de Claire Cornillon : http://lintermede.com/cinema-detachment-tony-kaye-adrian-brody-festival-deauville-2011.php
[5] Se reporter aux travaux de
J.Bowlby et de D. Winnicot.
[6] Elise Domenach, Stanley Cavell. Scepticisme et philosophie,
Paris, PUF, 2011.
[7] Frédéric Worms, La vie qui unit et qui sépare, Paris,
PUF, 2013.



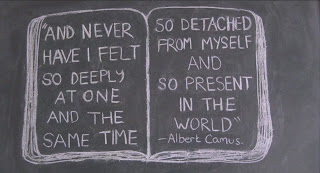
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire