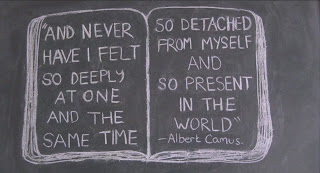L'ordre libertaire. La vie
philosophique d'AlbertCamus de Michel Onfray, Paris, Flammarion,
2012.
Rendre justice à Camus,
penseur capital mais oublié du XXe siècle, trop vite décrié par
ses ennemis comme un « philosophe pour classes terminales »,
tel est l'objet de ce nouveau livre de Michel Onfray. Cette occasion
de redécouvrir la vie et l'oeuvre de l'écrivain algérois, le
fondateur de l'Université populaire nous l'offre, non sans
s'attaquer par ailleurs avec la férocité qu'on lui connaît à une
autre grande figure officielle de la philosophie française, à
savoir Jean-Paul Sartre. En même temps qu'un éloge de Camus,
présenté comme véritable philosophe hédoniste, nietzschéen et
libertaire, l'ouvrage prend la forme d'une attaque au vitriole contre Sartre mais
aussi Beauvoir et la philosophie universitaire en général contre
laquelle Onfray ne mâche pas ses mots.
Comme toujours, le propos
est clair et s'appuie sur une lecture des œuvres complètes et de la
correspondance. Par ce moyen, comme il l'avait fait précédemment
avec Freud, Onfray entend déconstruire la légende et rétablir la
véritable histoire. Considérant que l'oeuvre est inséparable de la
vie et que l'harmonie des deux est précisément la preuve d'avoir
devant soi un vrai philosophe, l'auteur de cette psychobiographie
sans Freud nous replonge dans le passé de l'écrivain, son enfance
et les figures familiales décisives : un père mort trop tôt
pendant la première guerre mondiale auquel Camus restera fidèle,
une mère emmurée dans son silence mais aimante, une grand-mère
tortionnaire. De cette enfance , Camus semble en avoir retiré
au moins deux éléments clés pour la construction de son œuvre :
la misère et le soleil méditerranéen. L'ombre et la lumière, la
souffrance et l'action, ingrédient d'une philosophie tragique et
engagée. Sur cet itinéraire camusien, deux figures
institutionnelles, rappelle Onfray, jouent un rôle décisif :
son instituteur, Monsieur Germain, initiateur du livre, et Jean
Grenier, son professeur de philosophie au lycée. Onfray consacre un
chapitre entier de la première partie aux rapports officiels et
officieux entre Camus et ce dernier autour de la question de
l'engagement communiste de 1935-1937. Là encore, il déconstruit la
légende : Grenier comme Lequier son maître n'en ressortent pas
indemnes. L'important est de voir en Camus un philosophe en quête
d'un art de vivre en temps de catastrophe, un philosophe artiste,
fidèle à son enfance, soucieux de donner la parole à ceux qui ne
l'ont pas, attaché à rendre compte par une phénoménologie
singulière des expériences sensibles et jouissances simples du
corps, de mener viscéralement des combats contre l'injustice (peine
de mort, colonialisme, abus de pouvoir en tout genre) et pour la
liberté. Le football de sa jeunesse, le théâtre, le Collège du
travail, la Maison de la culture sont autant d'expériences
formatrices et de passions pour les expériences humaines et
communautaires. Miné par une maladie qui le condamne, la
tuberculose, Camus trouve les ressources de dire « oui »
à l'absurdité de la vie tout en opposant un « non »
ferme à toutes les formes de l'inhumain qui traversent l'histoire du
siècle. De fait, la pensée de Camus contient les principes d'une
utopie modeste, appelant à la résistance et la révolution par
l'éthique et l'art conjoints, une célébration aussi de
l'anarcho-syndicalisme. Voilà pourquoi, selon Onfray, il faut voir
en Camus le précurseur trop vite oublié de la « French
theory » (Foucault, Deleuze et Guattari, Derrida, Lyotard,
Bourdieu) et du post-anarchisme d'origine américaine (Todd May, Saul
Newman, Lewis Call). On en revient alors à la figure de Sartre et de
celle qui en a construit la légende, Simone de Beauvoir. Face à la
philosophie existentielle de Camus, la mode existentialiste, qui a
conduit Sartre à l'hégémonie sur la scène française dans les
années 60, semble incapable de résister et faire le poids. Sartre
collaborateur, Sartre communiste complice des goulags, Sartre devenu
maoïste, caution des pires crimes de sang, quand, après 68, il
perd sa crédibilité. Le procès fait chuté l'icône Sartre de son
piédestal. Onfray lance une nouvelle fois la polémique. Chacun se
fera juge de la vérité des propos.
On pourra regretter les nombreuses redites et cette manière binaire ou dichotomique de penser et d'opposer les philosophes et les personnes. Justice est en tout cas
rendue à l'égard de l'oeuvre majeure et inachevée de Camus.
Nietzschéen et désormais camusien, Michel Onfray reprend le
flambeau de ce combat d'un art de vivre en temps de catastrophe. A
l'évidence, il s'identifie et se reconnaît dans la vie et la pensée
de Camus au point où il pourrait affirmer, comme Flaubert l'a dit de
Mme Bovary et comme Camus aurait pu le dire de Meursault, l'antihéros
de son roman l'Etranger, « Camus, c'est moi ».
Mais bien d'autres pourraient aussi se retrouver dans cet itinéraire
et ces exigences. N'est-ce pas, en effet, une urgence vitale et le
devoir du moment présent que de nous mettre à l'écoute de cette
leçon camusienne : conquérir et préserver sa liberté ; combattre l'injustice ?